
Artiste et militant pour la paix et les droits de la personne, André Jacob est membre des Artistes pour la paix et retraité de l’enseignement en travail social à l’UQÀM. Il a publié en 2019, avec la participation de Tito Alvarado, Paul Chamberland, Michel Cibot, Raôul Duguay, Pour la paix, brisons le silence! Suivi du Manifeste pour la paix des Artistes pour la paix, aux Éditions de la Pleine Lune, Collection « Regards solidaires ».
Proclamé Lauréat du Prix du Public pour la Paix 2020-21, il a partagé avec Jean-Emmanuel Allard / Manu, illustrateur, communicateur et collaborateur aux Antennes de paix, sa manière de traduire par l’art pictural, l’écriture et l’action son espoir de participer à la construction d’un monde juste et plus humain.

Manu – Félicitations pour votre engagement. C’est impressionnant. Je propose de nous entretenir d’une thématique centrale pour une meilleure intelligence et compréhension du sujet : la relation entre art et engagement.
Dans la notion entre art et engagement – ce n’est pas tous les artistes qui sont engagés : – quel est le rôle de l’art dans l’expression de la solidarité et inversement quel est le rôle de la solidarité sociale au niveau artistique – une espèce de mariage dans les deux sens? Réflexion globale : Est-ce que l’art a un rôle à jouer dans la solidarité sociale, la dimension caritative, la dimension humaine d’une part, et d’autre part est-ce qu’une ouverture, une dimension sociale, une dimension humaine peut nourrir l’expression artistique?
André – L’art est un mode d’expression qui à la fois traduit l’âme d’un peuple et la culture d’une époque. Il y a mille façons d’envisager l’art. Il y a l’art qui sert essentiellement au divertissement ou à des modes de commercialisation. Mais l’art peut dépasser ces dimensions en essayant de lire la réalité à partir de perceptions qui lui sont particulières. Comment, par exemple exprimer le désarroi, comment exprimer la misère, et comment exprimer en même temps la joie, des sentiments positifs ? Ça ne va pas de soi.
Personnellement j’ai souvent été impressionné soit par des scènes, soit par des observations ou des témoignages qui m’ont permis de me lancer dans une sorte de recherche d’expression de ce que j’ai pu voir et entendre. Je donne comme exemple mes visites de camps de concentration nazis comme Auschwitz. J’ai été beaucoup touché, et cela m’a permis de réfléchir aux questions du génocide, de la Shoah et d’essayer par la suite de traduire cela en quelques œuvres d’art. D’une certaine façon, parfois le résultat me dépasse parce que je laisse aller mes émotions sur une toile ou sur papier, ce qui donne souvent un message contrasté et surprenant d’ombre et de lumière. Ce ne sont pas nécessairement simplement des zones d’ombres, des zones de noirceur comme on pourrait le penser au point de départ, mais de rayons de lumière et d’espoir.
C’est un peu la même chose avec mes écrits. Dans les années 80, après la guerre au Cambodge avec Pol Pot, j’ai été invité à participer à une Commission internationale d’observation sur le drame qui s’était joué là-bas; les scènes d’horreur observées m’ont inspiré un certain nombre de poèmes. Je me rappelle avoir écrit suite à l’observation de fosses communes où les opposants au régime, ou simplement les gens considérés comme des intellectuels étaient éliminés. Si je relis mon poème et je me dis : oui, il y a forcément un côté sombre, mais en même temps, à la fin, j’ouvre la porte à l’espoir ; l’humanité n’est pas faite que de drames. Les réflexes humains peuvent dépasser les périodes sombres. Voilà c’est un peu mon approche. Je ne fais pas une œuvre d’art à partir nécessairement d’une analyse très rationnelle, c’est la charge émotive qui me porte à le faire, que ce soit en poésie, en écriture ou en peinture.
Des œuvres romanesques
Manu – Vous avez eu recours à la fiction pour vous exprimer. Comment est-ce venu?
André – Si j’ai abordé des questions sociales en publiant quelques romans, c’est aussi à partir de situations sociales, d’observations plus analytiques, de recherches. Mais, en même temps, imaginer un roman rejoint un large auditoire, notamment des gens, des jeunes en particulier, pour susciter une réflexion sur des questions sociales dont on parle peu ou pas nécessairement dans la vie quotidienne. La forme du roman permet aux lecteurs et aux lectrices de suivre une trame, de vivre avec les personnages, de s’identifier et de se positionner par rapport à ce que les personnages vivent.
 Voici un exemple : La Saga de crin bleu, un roman destiné aux petits de 9-12 ans. Ce roman est né d’une expérience tout à fait particulière. Je faisais de l’animation avec des enfants d’écoles primaires au Musée de Charlevoix. L’exposition d’œuvres de Roger Ouellet, sculpteur naïf, fascinait les enfants, tout particulièrement son gigantesque cheval bleu. Ce cheval géant, d’à peu près trois mètres de hauteur, fascinait et questionnait les enfants, car au-delà de sa forme particulière il était peint en bleu. Des enfants disaient naïvement : c’est impossible un cheval bleu, ce n’est pas beau, mais d’autres le trouvaient merveilleux; à ce moment-là, j’ai réalisé que la couleur, simplement la couleur, provoquait des réactions, parce que la couleur était inhabituelle pour un cheval; la couleur pouvait être un prétexte au rejet. Dans mon roman La saga de Crin-bleu, un dialogue entre les pour et les contre la couleur du cheval devient le centre d’une réflexion sur la différence, en réalité le racisme et la discrimination. Dans la trame du roman, iI y a eu toute une épopée du cheval jusqu’à ce que finalement le propriétaire l’isole dans une forêt; il le rejette complètement parce qu’il trouvait que le milieu ambiant avait de la difficulté à accepter sa bête à cause de sa couleur.
Voici un exemple : La Saga de crin bleu, un roman destiné aux petits de 9-12 ans. Ce roman est né d’une expérience tout à fait particulière. Je faisais de l’animation avec des enfants d’écoles primaires au Musée de Charlevoix. L’exposition d’œuvres de Roger Ouellet, sculpteur naïf, fascinait les enfants, tout particulièrement son gigantesque cheval bleu. Ce cheval géant, d’à peu près trois mètres de hauteur, fascinait et questionnait les enfants, car au-delà de sa forme particulière il était peint en bleu. Des enfants disaient naïvement : c’est impossible un cheval bleu, ce n’est pas beau, mais d’autres le trouvaient merveilleux; à ce moment-là, j’ai réalisé que la couleur, simplement la couleur, provoquait des réactions, parce que la couleur était inhabituelle pour un cheval; la couleur pouvait être un prétexte au rejet. Dans mon roman La saga de Crin-bleu, un dialogue entre les pour et les contre la couleur du cheval devient le centre d’une réflexion sur la différence, en réalité le racisme et la discrimination. Dans la trame du roman, iI y a eu toute une épopée du cheval jusqu’à ce que finalement le propriétaire l’isole dans une forêt; il le rejette complètement parce qu’il trouvait que le milieu ambiant avait de la difficulté à accepter sa bête à cause de sa couleur.
En un mot, ce roman suscite un dialogue sur la question de la différence, de la discrimination, du racisme, et sur la couleur : le bleu. À la fin, je fais ressortir de façon très ludique que le bleu est une belle couleur acceptable même quand elle sort des critères établis. Le cheval se fait dire par un artiste-peintre que sa couleur est dans la nature, car il y a du bleu dans le ciel et la mer, sur des oiseaux et dans toutes sortes d’autres situations. Le bleu devient alors une couleur acceptée et acceptable. C’est un peu ce genre de truc que je fais de façon ludique.
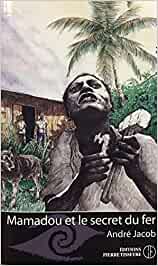 Un autre roman, Mamadou et le secret du fer, est né de mon travail social au Mali, 2004-2005. Au Mali, j’ai réalisé que beaucoup d’enfants travaillent et vivent dans les rues, en colonies comme dans les madrasas. Souvent, ils mendient seuls; ce sont des talibés, ces élèves des Madrasas, écoles coraniques traditionnelles, qui vont quêter dans les rues et chercher à manger. Par ailleurs, des enfants sont parfois répartis entre les familles, en raison de la pauvreté, et même des enfants sont vendus comme esclaves pour aller travailler dans les plantations de cacao, de café, dans les mines ou dans l’agriculture en Côte d’Ivoire.
Un autre roman, Mamadou et le secret du fer, est né de mon travail social au Mali, 2004-2005. Au Mali, j’ai réalisé que beaucoup d’enfants travaillent et vivent dans les rues, en colonies comme dans les madrasas. Souvent, ils mendient seuls; ce sont des talibés, ces élèves des Madrasas, écoles coraniques traditionnelles, qui vont quêter dans les rues et chercher à manger. Par ailleurs, des enfants sont parfois répartis entre les familles, en raison de la pauvreté, et même des enfants sont vendus comme esclaves pour aller travailler dans les plantations de cacao, de café, dans les mines ou dans l’agriculture en Côte d’Ivoire.
J’ai discuté avec beaucoup de gens de ce phénomène, qui correspond à une réalité cachée, ignorée, mais qui existe en des centaines de milliers d’exemplaires. J’ai documenté le sujet et j’en ai fait un roman qui raconte l’histoire de Mamadou. Comment Mamadou devient esclave dans une plantation de cacao, le parcours de sa famille, en passant par son voyage vers la Côte d’Ivoire, les transactions qui sont faites, le travail qu’il fait, ses astuces pour se libérer, s’organiser, se solidariser à partir de son expérience avec les jeunes qui vivent la même situation que lui. Cette question d’actualité constitue un enjeu absolument important. Le roman m’a permis de sensibiliser les jeunes à ce drame structurel qu’est l’exploitation des enfants forcés de travailler. Le livre a une valeur ajoutée en raison du Guide pédagogique qui l’accompagne. C’est une expression artistique qui est vraiment mariée à la vie, à un visage d’enjeux sociaux qui se passent ailleurs, mais qui permet de faire des liens avec des réalités d’aujourd’hui ignorées ici.
C’est toujours un peu la même démarche que je poursuis soit en écriture soit en peinture. C’est toujours à partir de situations sociales, que j’ai observées, des passages de ma vie que j’ai vécus. Je peux parler de mes autres livres si vous voulez…
L’artiste et le travailleur social
Manu – Est-ce qu’on peut dire que le travailleur social vient avant l’artiste ou l’artiste vient avant le travailleur social ?
André – Ces deux types de pratiques professionnelles sont tellement imbriquées au plus profond de moi qu’elles constituent mon idiosyncrasie. Mon expérience sur le plan de l’intervention sociale sous diverses formes alimente mon côté artistique depuis fort longtemps; je n’ai jamais vraiment séparé les deux. Au fil de ma carrière professionnelle comme travailleur social et comme professeur à l’Université, je gardais toujours cette pratique artistique, mon violon d’Ingres.
Manu – C’est pourquoi je veux revenir sur le sujet. C’est un élément intéressant. On a vu que la sensibilité sociale alimente le côté artistique. Est-ce que cette dimension artistique, cette dimension d’intériorité, de sensibilité, vous a donné, comparativement à d’autres qui sont juste dans l’action sociale, une plus grande sensibilité, une plus grande écoute? Est-ce que vous pensez que la sensibilité artistique permet d’appréhender des réalités sociales avec plus d’intériorité et de sensibilité ?
André – J’en suis convaincu parce que l’art touche les dimensions de la vie sur le plan social et émotionnel, l’art ne le fait pas en des termes analytiques. J’ai vécu l’expérience avec des enfants. Quand ils voient certains de mes tableaux, ils les voient avec le regard de l’enfant, un regard ingénu, un regard neuf. Souvent ils perçoivent d’abord ce qu’il y a d’émotion dans l’œuvre. Cela m’intéresse beaucoup parce que ce regard est différent de celui de l’adulte. L’adulte va souvent analyser la toile en fonction de la composition, la force d’expression des couleurs, son format et même se poser des questions banales : cette couleur-là irait bien avec le fauteuil de mon salon. Les jeunes ne voient que la dimension émotive, la profondeur du sens, la dimension spirituelle de l’œuvre pour dégager ce que cela leur dit par rapport à eux, par rapport à leur vécu, par rapport à d’autres personnes aussi.
Cette expérience je l’ai vécue souvent et c’est très parlant. Dans une œuvre on peut synthétiser une problématique qui est très complexe et en même temps la faire saisir sous un angle différent de celui de l’analyse sociologique ou psychosociale. D’une certaine façon, la perspective sociologique et l’artistique s’interpellent et se complètent. J’ai intégré cela d’une façon un peu naturelle, en autodidacte. Oui, j’ai suivi des cours en arts visuels, mais l’expression artistique dépasse la technique; il est question de rechercher le sens, la force de l’expression. Quand je travaillais avec Frère Jérôme, il répétait souvent que l’expression artistique doit être libre et puiser au plus profond des émotions de l’artiste.
Ce qui m’intéresse, ce n‘est pas vraiment la technique pour la technique. J’ai toujours dessiné, mais dans les années 1980, je m’étais inscrit à des cours de peinture. Au début, on nous faisait faire des natures mortes, des paysages. J’ai appris la technique, je l’ai perfectionnée; c’est intéressant, je vendais à peu près tout ce que je faisais comme œuvres figuratives. Une fois que j’eus compris comment cela fonctionnait, j’ai évolué assez rapidement vers une recherche plus personnelle, plus spontanée, plus introspective. Cette dimension-là, c’est Frère Jérôme qui me l’a inculquée; il répétait souvent: ce n’est pas votre technique qui m’intéresse, je veux savoir qu’est-ce que vous voulez dire par telle ou telle façon de vous exprimer. Sans négliger nécessairement l’aspect esthétique et technique de l’œuvre, en peinture, il insistait sur ce point. Je paraphrase sa pensée : si la moitié de ton tableau traduit vraiment quelque chose d’intéressant et d’harmonieux, l’autre, non, garde la moitié la meilleure moitié! Qu’est-ce qui parle, qu’est-ce qui est harmonieux? Qu’est-ce qui provoque une réaction contrastée? C’est l’expression que l’on recherche, le sens de l’œuvre. Cela m’a été très utile, son approche très libre, très libératrice aussi, sans les contraintes de la technique.
Tout cela se tient comme un tout. Je n’ai jamais eu de préoccupations commerciales pour ce que je fais. Je n’ai pas d’abord écrit ou peint, ou fait d’autres œuvres, pour dire cela va bien se vendre. Je ne me suis jamais posé cette question. Quand je faisais des paysages j’en vendais facilement parce que cela réfère à du connu. (…) J’ai toujours essayé d’avancer dans une expression moins contraignante, plus libre, sans me soucier de l’aspect commercial. Le côté esthétique, c’est autre chose. Je n’ai pas la prétention d’être un grand artiste; je m’exprime à ma manière, c’est tout. Des gens apprécient ce que je fais, d’autres moins. Voilà, c’est comme ça.
Manu – Iriez-vous jusqu’à recommander aux travailleurs sociaux d’avoir une certaine pratique artistique… pour avoir une plus grande perméabilité ?
André – Je ne l’imposerais pas. Plusieurs femmes et hommes en travail social sont sensibles à l’art ou pratiquent une forme d’art, par exemple l’art thérapie, la poésie, etc. Pensons à David Goudreault, un jeune artiste connu et fort actuel; il a une formation en travail social et, à ma connaissance, il reconnaît que sa formation l’aide dans son art, appuie le contenu sensible de ses œuvres, ses poèmes et tout. Ses deux pratiques sont liées.
Dernièrement quelqu’un m’a qualifié d’apôtre de la paix et des droits humains. J’ai ri un peu, mais je trouve aussi que c’est comme un signe qu’au fond de moi il y a une responsabilité par rapport aux questions sociales, la responsabilité de la parole, la responsabilité de l’échange, du dialogue. Quand je parle de discrimination, du racisme, de l’exploitation sociale, de l’exploitation des enfants soldats, des enfants esclaves, je mets la cape du militant qui se sent le devoir de parler de ces questions, de les exprimer, de les partager, de les faire comprendre, de responsabiliser d’autres personnes. Si moi je fais ma part, d’autres personnes peuvent le faire aussi. C’est une question de partage, de responsabilité. Je n’ai pas la prétention de sauver le monde seul.
Comme je le disais dernièrement à un jeune intervenant qui m’a téléphoné pour avoir les conseils, disons à la blague… d’un vieux sage. Il me parlait de ses projets. La première dimension d’une pratique à intégrer est de prendre conscience qu’on ne pas, pour utiliser une expression convenue, « sauver » le monde seul. Je lui ai dit : tu plonges à plein, tu veux sauver la planète sur le plan de l’environnement et de la pauvreté. C’est une intention louable. Prends du recul ! Trouve-toi des ami.e.s ! Des collaborateurs.trices ! Regarde où sont les alliés ! Approfondis les questions que tu abordes pour en connaître toutes les dimensions avant de plonger et de faire de l’activisme et penser que ça va marcher…
Manu – Si on revient à la publication sur Mamadou, qui visait le groupe d’âge des 12-18 ans, comment a-t-il été reçu ?
André – Je suis souvent allé dans les écoles secondaires avec ce livre. Il a été très bien reçu. Les jeunes ont été un peu étonnés, soufflés, souvent dans le doute. Beaucoup de jeunes ne croyaient pas possible que des jeunes soient esclaves aujourd’hui. Mais je leur disais : regardez ce que les organismes font comme travail, l’UNICEF, par exemple, pour comprendre cette situation, aussi pour sortir les enfants de cette exploitation. C’est un outil de sensibilisation extraordinaire, les jeunes étaient très émus, surtout quand les enseignant.e.s faisaient aussi leur travail pour explorer le contenu du livre. Ça change leur compréhension du monde, d’un monde qui les dépasse, un monde qu’ils.elles ne connaissent pas.
Une situation qui se vit au Mali ou en Côte d’Ivoire, c’est très loin de leur quotidien et de leurs préoccupations. C’est une façon de faire des liens avec la société de consommation dans laquelle nous vivons, une société qui provoque et génère des inégalités sociales. En faisant des liens avec de ce que d’autres jeunes vivent ailleurs d’une façon extrême, je peux montrer que leur bien-être fait partie d’une dynamique qui résulte de l’exploitation. Quand je leur dis que la tablette de chocolat achetée dans un dépanneur a de fortes chances d’avoir été produite à la base par des enfants qui travaillent dans une plantation de cacao, ils se demandent pourquoi. Parce que tout simplement les entreprises d’ici importent et transforment le chocolat produit dans des plantations en Côte d’Ivoire ou ailleurs. Ils voient le lien avec la production à la base. Cela déstabilise les jeunes, ce lien ne se fait pas naturellement, instinctivement. Je leur explique cela dans des termes très concrets. Alors les jeunes se disent qu’ils seront par la suite mal à l’aise d’acheter du chocolat. C’est un peu cela mon travail, de faire des liens avec la vie d’aujourd’hui, avec des réalités choquantes, mais qui existent réellement.
Le monde des romans graphiques
Manu – Ce livre de Mamadou est-il illustré ?
André – Il y a quelques illustrations, c’est quand même un livre de 200 pages. Les autres romans sont plus illustrés : La saga de crin bleu. Le journal de guerre d’Emilio, Les quatre saisons d’Elfina, ce sont des romans plus graphiques.
Manu – Qu’est-ce qui vous a amené au roman graphique? Pourquoi? Quel est votre intérêt ? Qu’est-ce qui fait la valeur du roman graphique ? C’est toujours la perspective de sensibiliser les jeunes à des réalités sociales?
André – L’intérêt du roman graphique vient des illustrations, des images, des photos utilisées et qui sont en lien avec le texte. Tout cela rend la situation encore plus parlante, les dialogues permettent de suivre visuellement la trame dramatique de l’ouvrage. C’est très fort et très puissant.
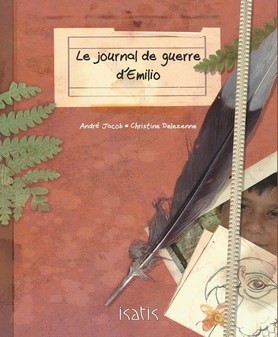 Par exemple, Le journal de guerre d’Emilio, écrit après avoir travaillé en Amérique du Sud. J’étais conscient de la situation des enfants soldats; peu de temps après la guerre qui a eu lieu au Salvador, j’ai rencontré des jeunes qui avaient été impliqués dans le conflit, des jeunes souvent traumatisés, blessés, physiquement, mentalement et moralement aussi, qui vivaient beaucoup de violence au fond d’eux-mêmes. Tout cela m’a amené à réfléchir à leur situation et j’ai résumé ma pensée autour d’un personnage que j’ai appelé Emilio, avec d’autres jeunes dans l’histoire. Alors l’illustratrice et moi avons travaillé pour que, sans nécessairement montrer juste le côté dramatique, on puisse montrer aussi la sensibilité de ces jeunes qui sont pris dans la dynamique d’une guerre. Faire voir et ressentir ce qui se dégage pour leur vie, en lien avec leur avenir, leur famille, leur éducation, leur confrontation à la violence, leur deuil aussi parce qu’ils perdent des amis. J’aborde toutes ces questions dans l’ouvrage. Les illustrations ont aussi le défi de lier les illustrations à des sujets très forts et très dramatiques.
Par exemple, Le journal de guerre d’Emilio, écrit après avoir travaillé en Amérique du Sud. J’étais conscient de la situation des enfants soldats; peu de temps après la guerre qui a eu lieu au Salvador, j’ai rencontré des jeunes qui avaient été impliqués dans le conflit, des jeunes souvent traumatisés, blessés, physiquement, mentalement et moralement aussi, qui vivaient beaucoup de violence au fond d’eux-mêmes. Tout cela m’a amené à réfléchir à leur situation et j’ai résumé ma pensée autour d’un personnage que j’ai appelé Emilio, avec d’autres jeunes dans l’histoire. Alors l’illustratrice et moi avons travaillé pour que, sans nécessairement montrer juste le côté dramatique, on puisse montrer aussi la sensibilité de ces jeunes qui sont pris dans la dynamique d’une guerre. Faire voir et ressentir ce qui se dégage pour leur vie, en lien avec leur avenir, leur famille, leur éducation, leur confrontation à la violence, leur deuil aussi parce qu’ils perdent des amis. J’aborde toutes ces questions dans l’ouvrage. Les illustrations ont aussi le défi de lier les illustrations à des sujets très forts et très dramatiques.
C’est un livre qui a marché très bien. Il a été finaliste pour le prix des bibliothèques publiques de l’Ontario. Juste à y penser, je suis encore ému de la réaction des jeunes quand je suis allé à Toronto pour participer à la remise du prix, il y avait des centaines de jeunes dans un amphithéâtre, quand la présentatrice a mentionné le titre de l’ouvrage, les jeunes se sont mis à applaudir et à scander : Emilio! Emilio! Je voyais donc que l’ouvrage les avait vraiment touchés. Ils s’étaient identifiés au jeune enfant soldat. À cette occasion, je me suis dit que j’ai atteint mon objectif.
Manu – Comment se passait la dynamique, parce que dans ce cas vous deviez partager la production avec l’illustratrice. Pour ces trois romans graphiques, comment se crée la dynamique?
 André – Ce n’est pas nécessairement un partage direct, par exemple dans la Saga de Crin bleu, je n’ai eu aucun contact avec l’illustratrice. C’est seulement la maison d’édition qui a décidé du type d’illustration. Dans le cas du Journal de guerre d’Emilio et des Quatre saisons d’Elfina, la maison d’édition Isatis a facilité la collaboration avec l’illustratrice. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté à la fois en présence à l’occasion et par Internet. Elle vit en Suisse et moi au Québec. Mais elle est venue ici et nous avons fait quelques séances de travail ensemble. Nous nous sommes entendus, il fallait que nous soyons d’accord tous les deux et sur le texte et sur les illustrations. C’est un travail à plusieurs mains. Il faut aussi une maison d’édition qui comprenne ce type d’ouvrage, qui accepte de les publier, et d’en faire la promotion pour qu’une œuvre circule, qu’elle rejoigne les gens, qu’elle joue son rôle.
André – Ce n’est pas nécessairement un partage direct, par exemple dans la Saga de Crin bleu, je n’ai eu aucun contact avec l’illustratrice. C’est seulement la maison d’édition qui a décidé du type d’illustration. Dans le cas du Journal de guerre d’Emilio et des Quatre saisons d’Elfina, la maison d’édition Isatis a facilité la collaboration avec l’illustratrice. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté à la fois en présence à l’occasion et par Internet. Elle vit en Suisse et moi au Québec. Mais elle est venue ici et nous avons fait quelques séances de travail ensemble. Nous nous sommes entendus, il fallait que nous soyons d’accord tous les deux et sur le texte et sur les illustrations. C’est un travail à plusieurs mains. Il faut aussi une maison d’édition qui comprenne ce type d’ouvrage, qui accepte de les publier, et d’en faire la promotion pour qu’une œuvre circule, qu’elle rejoigne les gens, qu’elle joue son rôle.
Manu – Parlez-moi un peu du dernier roman non encore publié. Ce n’est pas facile de trouver un éditeur. Quel travail vous avez dû faire pour trouver des éditeurs pour ces romans graphiques et quelle était la réaction des éditeurs ?
André – En général, j’ai travaillé avec des maisons d’édition [1] ouvertes à des enjeux à caractère social. Nous avons travaillé ensemble pour essayer d’arriver à un produit final qui corresponde à des normes esthétiques, des normes tout à fait adéquates. Il faut aussi que la maison d’édition s’implique. J’ai eu ce soutien avec La Maison Isatis qui est très engagée sur les questions sociales avec certaines collections spécialisées. C’est un travail d’équipe à réaliser.
Présentement je suis à travailler un prochain roman qui porte sur l’histoire d’une jeune réfugiée et de sa famille. Elle correspond à un profil assez original, ce sont des catholiques de Syrie réfugiés au Québec depuis quelques années. J’ai travaillé avec la famille. J’ai rencontré la famille à plusieurs reprises afin de pouvoir parle de leur situation et de la guerre en Syrie. Ce n’est pas un thème facile. Je comprends que ce n’est pas non plus un thème évident pour les éditeurs. Surtout les Éditeurs de littérature pour la Jeunesse, parce que ce qui domine c’est vraiment le monde du divertissement.
Moi j ’arrive avec des questionnements à caractère social, politique, sociologique et spirituel; cela se tient avec le cheminement des personnages, il me reste encore du travail de mon côté. J’ai frappé à la porte de quelques éditeurs, mais ce que j’ai présenté, ça n’a pas passé. J’ai confiance qu’un jour je vais y arriver. Parce qu’en même temps, je reçois des commentaires, je travaille encore pour améliorer mon œuvre.
L’avantage de l’écriture, comparativement à la peinture, c’est que je peux travailler assez longtemps un texte. Un tableau, je ne peux pas le travailler indéfiniment, il y a beaucoup de spontané. Je suis tenace, je ne désespère jamais d’arriver à réaliser mon objectif. Dans le dernier cas, je trouve que c’est un sujet très intéressant et très peu fouillé : la situation des catholiques syriens qui ont vécu la guerre pendant plusieurs années, avec tout ce que cela implique de discriminations, de peurs, de menaces. Ce n’est pas nécessairement un sujet facile, j’en conviens. Mais je garde espoir d’arriver à mes fins avant mes 100 ans.
Manu – Ça vous avait pris pas mal de temps à trouver un éditeur pour Le journal de guerre d’Emilio, Les quatre saisons d’Elfina?
André – Pas beaucoup. J’ai fait quelques recherches, je suis très content de la collaboration de deux maisons d’édition en termes de soutien, de promotion des ouvrages. Il faut faire un travail d’équipe pour arriver à un résultat intéressant. Je peux comprendre que pour une maison d’édition, ce que je fais peut paraître rébarbatif. Les maisons d’édition ont aussi des préoccupations commerciales, elles veulent aussi vendre des livres. Les livres que j’ai publiés à ce jour, malgré les thèmes difficiles, se sont bien vendus parce que ce sont des ouvrages utilisés dans les écoles. Il faut juste que je découvre la petite porte par laquelle entrer.
Manu – Quel avenir voyez-vous pour ce type de publication, le roman graphique engagé au Québec?
André – Il y a un créneau. Ça passe beaucoup aussi par les milieux de l’éducation; il faut trouver les réseaux d’organismes et de personnes qui s’intéressent à des questions sociales, à des enjeux sociaux, aux enjeux de la discrimination et du racisme, de la paix. Ce n’est pas nécessairement facile d’atteindre un grand public, j’en suis parfaitement conscient, mais ce n’est pas impossible. Il y a dans l’opinion publique pas mal de sensibilité pour ce genre de questions moins connues. Les situations que j’aborde, par exemple la situation des réfugiés syriens, ne font pas l’objet de l’actualité au quotidien. Ce n’est pas comme si on parle d’un artiste, on va faire des pages et des pages de journaux, d’émissions de télé. Il y a des promotions. On est dans le système du vedettariat.
Mes thèmes ne font pas partie du vedettariat, c’est plus difficile à promouvoir, cela fait partie de la réalité. Je vis très bien avec cela. Les quatre saisons d’Elfina, c’est un roman graphique qui marche bien. Ça touche une jeune immigrante. Déjà c’est le thème de l’immigration dont on entend parler dans les médias d’une façon assez régulière. L’immigration est un thème assez fort, l’exploitation d’une jeune immigrante. L’ouvrage a été traduit en anglais, les droits ont été achetés par une maison d’édition canadienne. Le livre circule partout dans le monde anglophone. Il y a une multiplication des débats à cause du livre qui est vendu et qui marche bien.
Et la poésie ?
Manu – Ça fait un beau tour de la question. … Si on abordait une autre dimension, celle de la poésie. Dans quelle mesure la poésie peut devenir un outil de sensibilisation sociale?
André – Le poème est un éclair avec une forte charge émotionnelle, sur une question souvent très précise. On ne peut pas traiter dans un poème plusieurs questions à la fois. On présente une illustration, des images, des émotions fortes avec des mots qui sont porteurs de sens. Parfois un poème devient une chanson et sera repris par beaucoup de monde. On pense « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel, « Quand les hommes vivront d’amour » avec Raymond Lévesque, ou une chanson que j’adore, une chanson écrite par Violetta Parra au Chili, « Gracias a la vida » popularisée par Victor Jara et interprétée maintenant par beaucoup de chanteurs dans le monde. Merci à la vie! C’est un thème fort et il n’y a pas de thème plus fondamental. C’est le merci à la vie, à ce que nous sommes, à la voix que nous avons, au regard que nous avons. Merci pour ce que nous sommes.
Ma poésie c’est un peu la même chose, comme mon écriture ou ma peinture, c’est l’expression d’un choc émotif, d’une situation qui me fait ressentir des émotions fortes, qui me choquent, qui me bouleversent et qui se traduit par des images, de bien des façons, ce n’est jamais pareil. Je suis à préparer un recueil autobiographique et je relis des textes écrits depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui; je me répète au fil du temps, ce sont toujours des thèmes ou des sujets qui comportent une dimension sociale et émotive qui me font réagir et qui font que je crée quelque chose à partir de cela.
Manu – Pour faire le lien, qu’est-ce que vous pensez de ce mariage musique et poésie, qui devient un art plus multidisciplinaire ?
André – Je suis tout à fait d’accord, je ne suis pas assez compétent pour faire de grandes réalisations d’un haut niveau technologique, mais j’enregistre parfois un poème qu’on me demande. J’ai organisé la présentation de poèmes sur la paix avec une danseuse professionnelle et une musicienne.

Izabella Marengo et André Jacob : Nous sommes la Paix (CM)
Actuellement, par exemple, pour le Festival Paroles dans le monde, j’ai un projet d’enregistrer un poème avec une musicienne. On travaille en équipe. Il ne devrait pas y avoir de frontières entre les formes d’art. On peut très bien écrire un poème sur une toile. Il y a bien des façons de marier les différents modes d’expression. Aujourd’hui, c’est encore plus explosif et plus dynamique parce que les moyens sont tellement plus grands, tellement formidables et complémentaires; avec la technologie actuelle, on peut faire des réalisations absolument fantastiques. J’avoue très honnêtement que je ne suis pas très habile au niveau de l’utilisation des technologies, par exemple quant à l’utilisation de l’informatique en arts contemporains. Il faudrait que je trouve des personnes qui font ce boulot et qui pourraient reprendre une partie de mon œuvre et la travailler pour en faire des productions mixtes. Un peu comme j’ai fait avec les illustratrices.
Manu – Pour terminer, vous avez probablement trouvé une forme de collégialité avec des artistes pour la paix. On retrouve chez beaucoup d’artistes cette composante, qui est à la fois sensible à l’engagement social, à une prise de parole, à une prise de position, un engagement qui est à la fois une expression artistique.
André – Au niveau des Artistes pour la paix, la plupart des artistes qui ont été membres et ceux qui participent toujours, ce sont des gens qui ont justement des préoccupations souvent sociales, des gens qui sont sensibles aux dimensions de la vie, qui sont sensibles à la discrimination, à la violence, aux inégalités sociales, … des artistes dans tous les domaines. Ça fait partie un peu de la personnalité d’un artiste d’être sensible. Les artistes, nous travaillons beaucoup avec les émotions, ce qui nous amène souvent à agir pour améliorer le bien-être des gens autour de nous.
J’ai travaillé avec Judy Richards et Yvon Deschamps, des artistes pour la paix, qui sont des gens très connus et très engagés, qui veulent partager leurs expériences avec la communauté, et redonner à la communauté ce qu’ils ont reçu du public. C’est un travail d’échange, de dialogue, de participation conjuguée, d’efforts communs. La paix ne peut avoir lieu sans justice sociale. Quand il n’y a pas de justice sociale, il y a souvent des situations d’exploitation, de domination, de répression. Tout est lié.
L’artiste ne peut pas travailler en silo; il dépasse l’analyse. Il exprime le ressenti par rapport à des situations par différents moyens. Pour un grand nombre d’artistes, c’est toute leur vie qui est engagée. Je pense à Richard Desjardins, Raôul Duguay, Yvon Deschamps, il y en a plein au Québec. Des grands poètes dans le monde comme Aragon, Paul Éluard, Garcia Lorca, Pablo Neruda. Des artistes engagés, ça fait partie de l’histoire de la vie artistique. On peut remonter dans le temps, citer des compositeurs comme Victor Hugo, ou un Dmitri Chostakovitch qui a composé sa fameuse symphonie no 5 en ré mineur opus 47 pour faire un pied de nez aux forces nazies qui pilonnaient Leningrad depuis des mois. Cette œuvre est riche et exprime le désarroi et l’espoir avec une puissance évocatrice inoubliable. L’engagement social et politique, c’est un sujet vaste comme le monde.
Manu – En terminant quel conseil donneriez-vous à un jeune qui sentirait un appel pour devenir un artiste engagé? En tant que sage, quel conseil vous lui donneriez pour parvenir là où il voudrait se rendre?
André – Le premier conseil que je donne souvent, c’est : ne restez pas seul dans votre univers, juste autour de votre moi, travaillez en observant le monde autour de vous, travaillez aussi avec d’autres personnes, travaillez en solidarité. Pour moi le mot solidarité c’est comme un mot sacré, c’est la clé du changement, c’est la clé pour travailler au mieux-être du monde. Aussi c’est responsabiliser du monde autour de nous, autour de grands thèmes. Dans notre environnement quotidien, il y a des événements qui nous parlent. Je pense à la protection de l’environnement, qui nous concerne tous et toutes et concerne l’univers entier. Ce ne sont pas les thèmes qui manquent.
En travaillant seul, on est condamné à mourir d’ennui. Bien souvent on m’a posé la question : pourquoi ne pas travailler davantage dans une perspective commerciale pour vendre plus de livres, plus de tableaux ? L’un n’exclut pas l’autre. Ce sont des questions de circonstances, des questions là où la vie nous amène. Il y a des artistes qui gagnent bien leur vie avec leur art et qui sont aussi engagés socialement, d’autres le sont moins.
Le mot clé : la solidarité, l’échange entre les artistes, entre les gens de différents milieux. On ne sauve pas le monde seul. Nous ne sommes pas seuls.
Manu – Excellent, un bon rappel. Merci pour ce partage de votre expérience sociale et artistique.
[1] Les Éditions Isatis, Les Éditions Pierre Tisseyre
Magnifique et éloquent témoignage. Merci, André!…