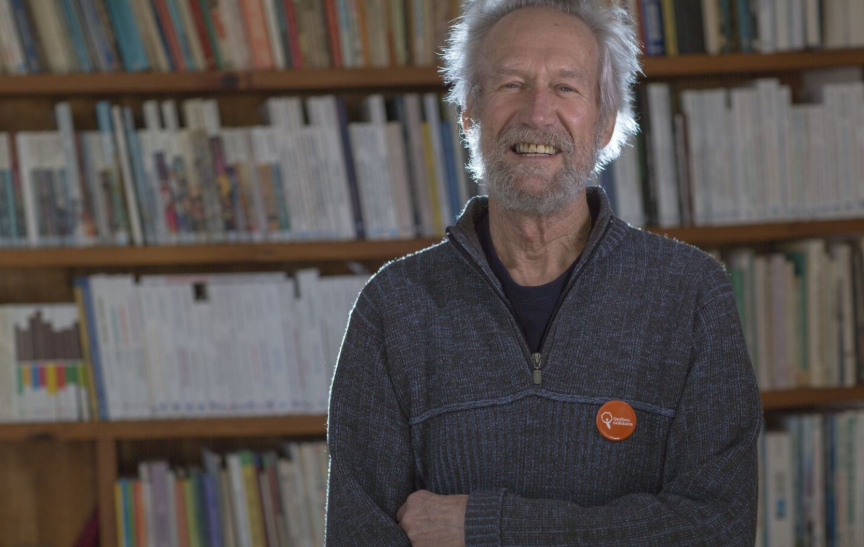
Photo: Pedro Ruiz Archives Le Devoir Serge Mongeau, photographié ici en 2014
Élodie Comtois, Barbara Caretta-Debays, David Murray, Kevin Cordeau et Olyvier Leroux-Picard avec Françoise David, Louise-Andrée Lauzière, François Larose, Valérie Lefebvre-Faucher, Dimitri Roussopoulos, Françoise Forest, Jean-Claude Saint-Onge, Jacques Gélinas, Nicolas Calvé, Alain Péricard, Danièle Blain, Marie-Eve Lamy, Marcel Sévigny et la grande famille d’Écosociété.
Le Devoir 13 mai
« J’ai demandé l’aide médicale à mourir. Je n’ai plus la capacité de poursuivre les actions essentielles pour mener notre société vers une vie frugale, écologique et communautaire. » C’est sur ces mots que Serge Mongeau nous a quittés le 9 mai dernier. Jusqu’au bout, ce militant à la force tranquille aura mené sa vie comme il l’entendait. Comment rendre justice à cet homme habité par une détermination à toute épreuve et qui s’est toujours mis « au service de la collectivité » ? Tâchons de témoigner de la vie digne et inspirante que fut celle de notre ami et camarade de lutte, marquée au sceau de l’engagement et de la recherche d’un « nouvel humanisme », lui qui fut à la fois médecin, organisateur communautaire, éditeur éclairé, infatigable lecteur, militant écologiste, jardinier et à l’origine d’un nombre impressionnant de groupes et de mouvements engagés pour la justice sociale.
Guérir les maux de la société
Pour plusieurs, évoquer le nom de Serge Mongeau, c’est parler du docteur Mongeau, une épithète qui lui collera étrangement à la peau sa vie durant, alors qu’il n’aura pratiqué la profession de médecin qu’à peine deux ans ! S’il renonce rapidement à la pratique médicale traditionnelle pour investir le champ de l’organisation communautaire, c’est parce qu’il comprend très tôt que plusieurs des maladies résultent de l’organisation déficiente de notre société. C’est notre société qui est malade, ce sont nos façons de vivre qu’il faut changer.
Cette sensibilité pour les questions sociales, il l’a toujours cultivée. On le verra ainsi s’impliquer dans de multiples causes liées aux enjeux sociaux : planification familiale, sexologie, politiques de population, rédaction d’articles dénonçant les travers du système de santé, participation aux premiers centres locaux de services communautaires (CLSC), sans parler de sa contribution à la mise sur pied de la collection « Santé » chez Québec Amérique dans les années 1980.
Il exposera sa vision dans de nombreux essais, d’Adieu médecine, bonjour santé (1982) à Moi, ma santé (1994). C’est de la même façon qu’il faut comprendre la grande passion qu’il éprouvait pour la course à pied, mais également pour le vélo, qu’il aura pratiqué quotidiennement été comme hiver aussi longtemps que ses capacités physiques le lui auront permis, soit bien au-delà de ses 80 ans. Sans oublier le jardinage, auquel il s’adonnera tout au long de sa vie pour garder un lien avec la terre, avec la nature — un autre remède pour affronter les difficultés de ce monde.
De la simplicité volontaire à la décroissance
Quand on évoque la figure de Serge Mongeau, la simplicité volontaire vient naturellement en tête. Par son essai La simplicité volontaire, il aura contribué plus que quiconque au Québec et dans la francophonie à populariser cette critique de la consommation et un appel à s’investir dans sa communauté. Cela lui vaudra d’être souvent appelé le « père de la simplicité volontaire ». Les fondements philosophiques de ce courant se trouvent dans les écrits de Thoreau, Tolstoï et Gandhi, mais aussi parmi les précurseurs de la décroissance que sont Illich, Ellul ou Charbonneau. Son nom figure à côté des leurs au panthéon de l’écologie politique.
On ne compte plus le nombre de personnes ayant témoigné de l’influence de ce livre sur leur trajectoire de vie. Dans cet ouvrage qui a marqué le paysage littéraire et intellectuel québécois, on retrouve les idées qui ont guidé la pensée et l’action politiques de Serge Mongeau tout au long de sa vie. Un message à la fois simple et direct : « C’est notre civilisation qui est malade, notre société qui ne répond plus adéquatement à nos besoins les plus profonds. Passé ce constat, il ne faut pas baisser les bras. Notre société n’est pas immuable : nous en faisons partie, nous la constituons et nous pouvons la changer. »
Loin d’être un simple appel à une discipline de vie personnelle frugale, centrée essentiellement sur la transformation de soi, la simplicité volontaire répond à sa profonde conviction que les réels changements se conjuguent au collectif. Pour lui, la critique de la consommation et de la place du travail s’inscrit dans une réflexion collective plus large. C’est ce qui explique qu’à partir du milieu des années 2000, il se fera l’un des plus ardents défenseurs de l’idée de décroissance au Québec. C’est dans le même esprit qu’il s’implique dans le mouvement des Villes en transition par la mise sur pied du réseau Transition Québec.
Une vie politique
Un bref coup d’œil à sa feuille de route politique illustre en fait toute l’importance qu’accordait Serge Mongeau au collectif. Du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques — qui lui vaut d’être incarcéré à l’occasion de la crise d’Octobre de 1970 — à la promotion du foncier communautaire en passant par Nos impôts pour la paix, on ne compte plus les organisations et collectifs qu’il a fondés, intégrés ou animés. Rien que dans les vingt dernières années de sa vie, citons le Réseau québécois pour la simplicité volontaire, le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale, le collectif Échec à la guerre ou le Comité citoyen de Parc-Extension.
Malgré sa méfiance envers les sources du pouvoir, il n’a pas non plus hésité à devenir candidat indépendant aux élections québécoises de 1970 et à se porter candidat pour Québec solidaire en 2008. Témoin direct du coup d’État ayant renversé le président Allende au Chili en 1973, il savait combien la démocratie est précieuse et ses institutions, fragiles.
Le legs d’Écosociété
Serge Mongeau fut aussi un grand éditeur, toujours au service des idées. L’un de ses legs les plus importants est sans aucun doute d’avoir contribué à mettre sur pied une maison d’édition devenue incontournable dans le paysage littéraire francophone : Écosociété.
On ne saurait en effet sous-estimer son apport au sein du paysage éditorial, surtout quand on pense aux nombreuses vocations militantes que les ouvrages publiés par Écosociété ont fait naître. C’est notamment grâce à son dynamisme que la maison fera connaître les idées phares de l’écologie sociale, accompagnera l’essor du mouvement altermondialiste au tournant des années 2000 et lancera plusieurs grandes plumes de la gauche québécoise. Cultivant un catalogue pour passer de la théorie à l’action, la ligne éditoriale de la maison reflète à merveille le titre de son dernier livre : s’indigner, oui, mais agir.
Que ce soit en tant qu’auteur, éditeur, membre du comité éditorial ou du conseil d’administration, Serge Mongeau aura été pendant 25 ans de tous les combats de la maison d’édition. Il disait qu’Écosociété est le legs dont il était le plus fier. Sans doute parce que la maison incarne fidèlement l’engagement qui fut le sien. Dans son autobiographie, il disait souhaiter qu’on retienne de son histoire « l’importance d’une foi indomptable en notre capacité de modifier notre avenir et, en corollaire, la nécessité de s’engager et de persister dans ses actions ». Cette conviction de l’engagement collectif pour rendre notre monde meilleur, c’est encore aujourd’hui ce qui anime Écosociété.
Un héritage collectif
Comment témoigner avec justesse du parcours de cet homme qui aura été de tous les combats de son époque tout en menant une vie digne et simple ? Nous l’affirmons sans détour : Serge Mongeau fut l’une des figures intellectuelles et militantes les plus importantes des 60 dernières années au Québec. « Toute mon activité est sous-tendue par un même objectif : arriver à ce que, collectivement, nous prenions conscience de la nécessité de réorganiser notre société pour que tous puissent y vivre de façon décente aujourd’hui comme demain », écrivait-il dans son autobiographie. Et c’est effectivement là un des plus précieux engagements qu’il nous lègue.
Mais au-delà de l’homme d’action et de conviction, rappelons également que Serge était un ami fidèle, un père aimant, un conjoint attentif, un mentor généreux, un collaborateur précieux, un exemple d’intégrité et d’engagement.
Aujourd’hui, nous sommes en deuil. Nous lui devons tant collectivement. À nous, demain, d’agir pour poursuivre son combat pour une vie frugale, écologique et communautaire.
1 commentaire
- Pierre Jasmin - Abonné 13 mai 2025 06 h 42
Serge Mongeau, les Artistes pour la Paix sont en deuil
Son ouvrage La SIMPLICITÉ VOLONTAIRE est vite devenu un idéal exigeant à suivre pour nos membres.
Combien de fois avons-nous interpellé le gouvernement fédéral et ses folles dépenses militaires qui hélas sont appelées à augmenter avec le nouveau Premier ministre qui a fait de sa volonté de porter à 82 milliards de $ annuels son budget militaire, son principal argument lors de sa rencontre avec Donald Trump? On se souviendra plutôt de la contestation de Serge dans Nos impôts pour la Paix et de sa vie militante et exemplaire.
Aucun commentaire jusqu'à présent.